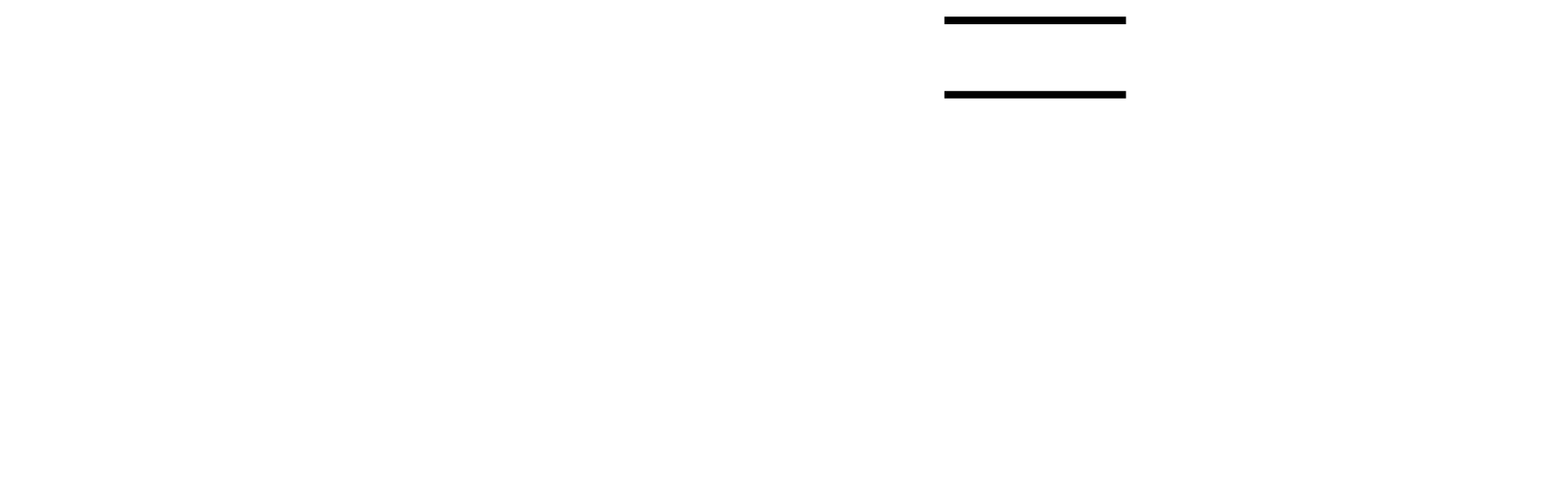La motivation première de cette constitution était de former une municipalité de campagne associée à la nouvelle paroisse, soit celle de la cathédrale, érigée canoniquement en 1853. L’année précédente, Saint-Hyacinthe était devenu le troisième diocèse de la province après Québec et Montréal.
Qui était saint-Hyacinthe le Confesseur?
Jacques-Hyacinthe Delorme, premier seigneur de Saint-Hyacinthe, choisit saint Hyacinthe le Confesseur comme saint patron. Celui-ci naquit en 1185 en Pologne. Vers 1221, il devint dominicain et reçut son habit des mains de saint Dominique lui-même, à Rome. Il s’installa tout d’abord à Cracovie, en Pologne. Il partit ensuite évangéliser la Pologne, la Russie, la Prusse, l’Ukraine, les pays scandinaves et finalement l’Écosse.
De la fondation au morcellement
Joseph Robitaille fut le premier maire de Saint-Hyacinthe-le-Confesseur. Au début, il y avait six arrondissements. En 1872, un arrondissement dit agraire est ajouté. En plus des trois arrondissements agraires ou champêtres, voici les localisations des autres arrondissements qui composent la municipalité :
– l’emplacement du futur village de Saint-Joseph;
– de la route de Saint-Dominique jusqu’à Saint-Dominique;
– du Rapide-Plat Sud jusqu’à la paroisse de Sainte-Rosalie;
– le Rapide-Plat Nord (anciennement dans la seigneurie de Saint-Ours).
En 1892, deux autres arrondissements sont ajoutés.
Saint-Hyacinthe-le-Confesseur s’activa pour équiper les parties plus urbanisées de son territoire. Tout d’abord, en 1884, on installe des trottoirs en bois dans le futur Saint-Joseph. En 1885, on creuse un canal pour verser les égouts dans la Yamaska. Bien sûr, on était conscient de la pollution, mais la croissance rapide de Saint-Joseph força cette décision. Le côté nord de Saint-Hyacinthe ne fut pas en reste. Le système d’aqueduc de Saint- Hyacinthe fut prolongé jusqu’au village (hameau) Casavant. On y installa des trottoirs en bois. Puis en 1944, l’asphaltage fut complété au village ou au hameau. C’est ainsi qu’on termine la rue Girouard jusqu’au cimetière.
Au tout début de l’agglomération, on fonda une compagnie d’assurance, afin d’être protégé contre le feu et, en 1950, on s’entendit avec la Ville de Saint-Hyacinthe pour l’utilisation de son service d’incendie. Au début, Saint-Hyacinthe répondit à tous les appels provenant de Saint-Hyacinthe-le-Confesseur, celle-ci s’occupant ensuite de rembourser les frais à Saint-Hyacinthe. Après quelques évaluations, on se tourna vers le village de Saint-Joseph de 1961 à 1966 pour revenir avec le service de Saint-Hyacinthe de 1966 à 1970. Puis, on se tourna vers Saint-Simon jusqu’en 1985 et vers Saint-Dominique jusqu’à la grande fusion de 2001.
En 1898, il y eut la fondation du village de Saint-Joseph. En 1946, on annexa à la Ville de Saint-Hyacinthe la paroisse Assomption, qui sera surnommée l’Annexe. En 1969, le village (hameau) Casavant fut annexé en même temps que les versants Nord et Sud du Rapide-Plat. En 2001, sous l’impulsion du gouvernement provincial, Sainte-Rosalie, Saint-Thomas-d’Aquin, la paroisse Notre-Dame (à l’ouest de La Providence) et tous les restes de Saint-Hyacinthe-le-Confesseur furent réunis au grand Saint-Hyacinthe.
Deux personnages sont à retenir particulièrement et considérés comme des incontournables. Tout d’abord, Édouard Morier, notaire, qui occupa le poste de secrétaire-trésorier de la municipalité de 1922 à 1979, soit 57 ans. Puis, Ludovic Pelletier, qui fut maire durant plusieurs décennies, à partir de 1967. À la fusion en 2001, Rosaire Martin occupait la fonction de maire.
Par André A. Bourgeois, membre du Centre d’histoire de Saint-Hyacinthe