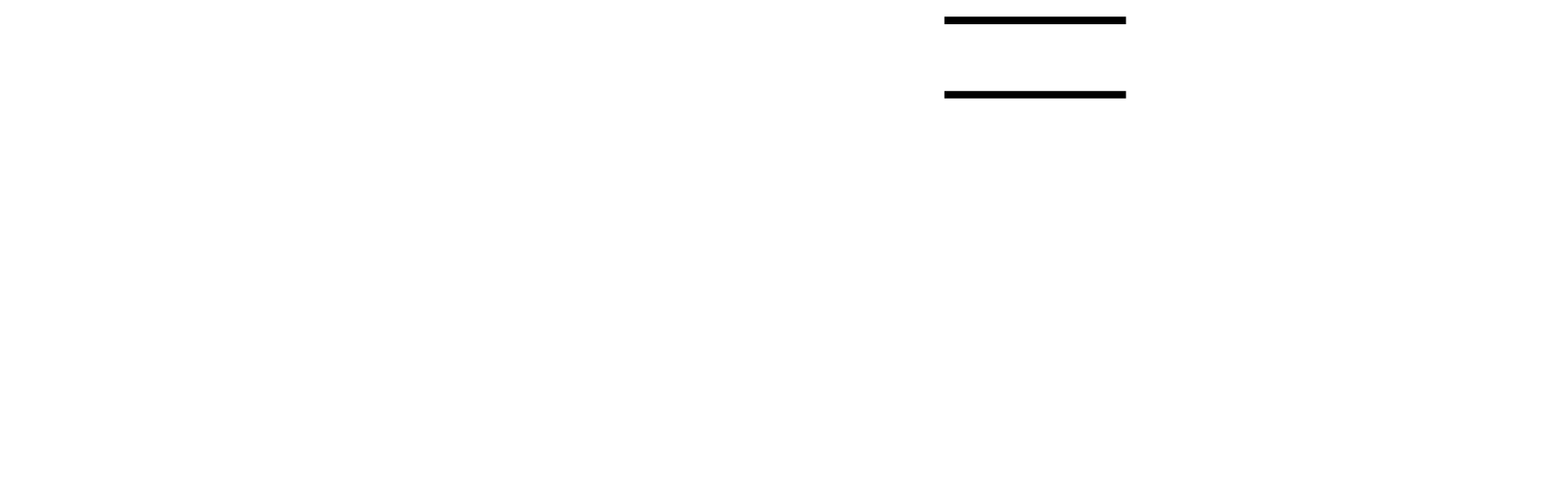Ottawa et l’utilisation des crises politiques
Ottawa a toujours profité des crises pour accentuer son unitarisme et se centraliser davantage, au détriment des provinces et tout particulièrement de la seule d’entre elles qui aspire à être le foyer d’une nation distincte, le Québec. La politique est affaire de rapport de force, et le gouvernement sait utiliser les conjonctures qui lui sont favorables pour nourrir son appareil tentaculaire.
Ce fut le cas, en 1840, alors que le pouvoir anglais profita de l’écrasement de la rébellion des Patriotes pour procéder à l’union forcée des deux Canada. Ce fut le cas après les deux guerres mondiales, alors que des impôts fédéraux qui se voulaient temporaires sont finalement devenus permanents. Ce fut le cas après la défaite de l’option souverainiste de René Lévesque lors du référendum de 1980, quand Pierre Eliott Trudeau et Jean Chrétien en profitèrent pour rapatrier unilatéralement la Constitution canadienne sans l’accord du Québec (qui n’en est toujours pas signataire à ce jour), lui retirant du même coup son droit de veto. Ce fut également le cas après le référendum de 1995, avec le déséquilibre fiscal mis en place entre Ottawa et les provinces à travers la réduction des transferts fédéraux (principalement en santé et en assurance-emploi) et l’utilisation de ces nouveaux surplus budgétaires dans la création de programmes centralisateurs envahissant les juridictions provinciales. Ce fut le cas pendant la crise sanitaire de la COVID- 19, avec l’annonce de la création de nouvelles structures bureaucratiques.
Il y a donc fort à parier qu’Ottawa en profitera encore, cette fois, avec la crise des droits de douane. À ce titre, la nouvelle mode consistant à prôner la suppression des barrières au commerce entre les provinces fait figure de cheval de Troie.
Ce qui se trame
Au nom de la menace extérieure, on a pu entendre, au cours des dernières semaines, la ministre Mélanie Joly évoquer la construction d’oléoducs qui traverseraient les provinces, le chef conservateur Pierre Poilievre promettre la relance du projet de gaz naturel liquéfié au Saguenay, et les aspirants chefs du Parti libéral du Canada Mark Carney et Chrystia Freeland menacer de couper les transferts en santé aux provinces en guise de levier de négociation. Tout ceci va dans le même sens : celui d’une volonté d’utilisation de l’actuelle crise pour centraliser davantage le régime canadien et éliminer la distinction politique et économique québécoise.
Quant aux prétendues barrières au commerce entre les provinces qui seraient à honnir et à éliminer, de quoi parle-t-on? S’agit-il du taux de syndicalisation, plus élevé que partout ailleurs au Canada ? Du Bureau d’audience publique en environnement (BAPE) et des normes écologiques? Des lois linguistiques, qui imposent des contraintes en matière de langue de travail, d’étiquetage et d’affichage? Du rapport d’impôt provincial pour les entreprises? De la SAQ et des normes en matière d’alcool? De l’obligation de transformer au Québec le bois coupé dans les forêts publiques québécoises? De la réglementation provinciale des valeurs mobilières? De l’accréditation professionnelle québécoise des médecins et infirmières, une juridiction exclusive des provinces?
Toutes ces particularités québécoises peuvent être considérées comme des barrières au commerce entre les provinces, mais constituent aussi ce qui forge notre caractère national, avec des façons de faire qui nous sont propres. Dans sa nouvelle et tardive défense de sa propre indépendance, Ottawa pourrait en profiter pour réduire encore plus la marge de manoeuvre des Québécois et Québécoises au sein du Canada.
Qui parle en notre nom?
Ne l’oublions pas : Ottawa demeure un État contrôlé par une autre nation (et le poids du Québec en son sein est en réduction constante). Cet État, qui parle en notre nom à l’étranger, sera appelé à négocier avec Washington sur des questions qui touchent étroitement les intérêts économiques fondamentaux du Québec. C’est Ottawa qui a choisi de se battre pour l’acier ontarien plutôt que pour l’aluminium du Québec lors des négociations commerciales avec les États- Unis et le Mexique en 2020. C’est Ottawa qui a choisi de sacrifier les fromages du Québec au profit du boeuf de l’Ouest canadien lors de l’entente avec l’Union européenne (une des trois brèches dans la gestion de l’offre dans le cadre d’accords négociés par le Canada). C’est Ottawa qui, lors de la crise du papier en Les peddlers 2008, a injecté 10 milliards $ dans l’automobile ontarienne et prêté un maigre 60 millions $ aux industries forestières. C’est également Ottawa qui a accepté des compromis, dans plusieurs accords commerciaux, par rapport au principe de l’exception culturelle, grand combat du Québec, qui vise à exempter le milieu culturel des lois agressives du libre-échange. Ottawa mérite-t-elle vraiment qu’on lui donne le Bon Dieu sans confession?
Cela ne signifie certainement pas que les négociateurs canadiens soient foncièrement incompétents, mais qu’ils font la promotion de leur pays à eux. Il n’existe, par ailleurs, aucune règle pour que les provinces puissent participer aux négociations internationales, même lorsqu’elles sont directement touchées par ce qui sera adopté.
Une nation est toujours gagnante lorsqu’elle se représente elle-même, selon ses valeurs et intérêts fondamentaux. Les Québécois et Québécoises, une fois l’émotion de la présente crise passée, s’en souviendront assurément à nouveau. Les élites canadiennes, maintenant étonnamment en amour avec le concept de souveraineté, seront bien mal placées pour nous le reprocher.
Simon-Pierre Savard-Tremblay, député de Saint-Hyacinthe–Bagot, porte-parole du Bloc québécois en commerce international et vice-président du Groupe interparlementaire Canada–États-Unis