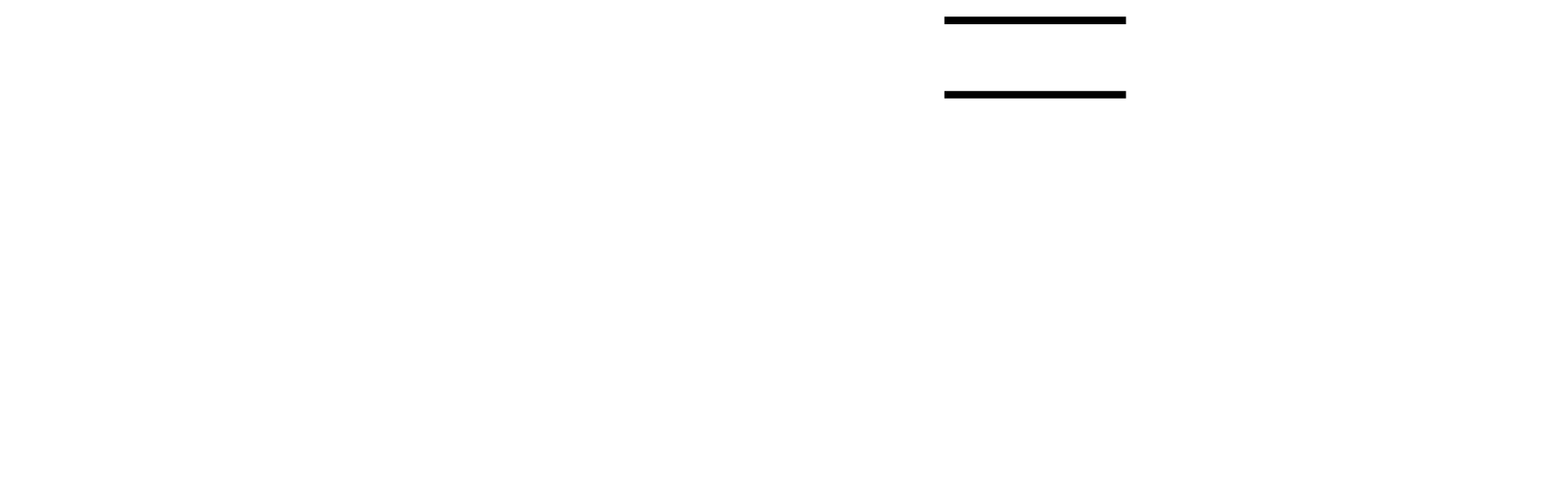Au début des années 2000, le philosophe Philippe Muray disait que nous entrions dans l’ère du festivisme, qui se traduit par une injonction permanente à la fête, au ludique, au divertissement, à perdre la tête. L’homo festivus ne cherche qu’à entrer dans un état second de confusion onirique, où il peut enfin fuir la dure réalité. Il veut fêter pour fêter : ne remettez surtout pas son plaisir en question, car là réside le salut dans une société ayant abandonné la foi. À l’image de ce nouvel homme que décrivait l’écrivain français, nous pouvons dire que Saint-Hyacinthe, après 250 ans d’histoire, entame son entrée dans le festivisme.
On comprendra que le centre-ville n’était pas en mesure de rivaliser avec sa Némésis, le nord de la ville et son aimant : le centre commercial. À proximité de l’autoroute, possédant toutes les commodités, les stationnements gratuits, les grandes chaînes américaines, le cinéma, l’hôtel de prestige, le nord de la ville avait été pensé pour entrer de plain-pied dans la modernité. Mieux : pour supplanter l’ancienne ville, trop archaïque, dépassée, périmée.
Face à ce rouleau compresseur, que pouvait faire le bas de la ville? Les commerçants se mirent à écrire des lettres dans les journaux, à se créer une société de développement inutile, à voter pour le « candidat du peuple » qui revire sa veste au premier soubresaut. La dernière innovation en date : piétonniser la rue principale en pleine pandémie (bonjour l’expérience d’achat), sans animation, et persister dans le projet, par orgueil mal placé, même au constat manifeste de l’erreur. Pendant ce temps, le Pépé fermait, le Bouffon suivait dans la chute : le départ de ces deux grandes institutions des années 1990 et 2000 arrachait une partie de l’âme maskoutaine.
Il y a quelques années, le géographe français Christophe Guilluy parlait de son pays comme étant divisé entre, d’un côté, la France du centre, celle des grandes métropoles, et de l’autre côté, celle des régions limitrophes. Cette dernière, appauvrie, inquiète, en décalage avec le mondialisme et habitée par le Français moyen encore enraciné dans sa famille, sa patrie et ses valeurs, il la nommait très justement la France périphérique. C’est cette France désespérée qui est sortie dans les rues en enfilant le gilet jaune, il y a deux ans. De ce côté de l’Atlantique, on peut dire que la COVID a accentué le contraste entre le nord et le bas de la ville, ou ce que nous pourrions aussi nommer le Saint-Hyacinthe du centre et le Saint-Hyacinthe périphérique.
Le propre de la périphérie est de ne pas figurer sur la liste des priorités, de ne pas être le centre de l’action politique. Bref, d’être le dernier des soucis. Une région périphérique, à l’ère de la mondialisation et du sacro-saint Progrès, est condamnée à la déchéance. Tout ce qui est vieux doit faire de l’air : seul ce qui est fraîchement né possède une valeur.
Bien sûr, il y aura toujours quelques discours et initiatives émis par les autorités en place pour promettre mers et mondes aux laissés-pour-compte. Ces petites actions ne sont évidemment qu’un os lancé au chien. En réalité, l’avenir de Saint-Hyacinthe, pour nos élus, se situe ailleurs : au nord du nord, comme chantait Vigneault. En témoignent toutes les permissivités qui lui sont laissées et les intransigeances exigées aux commerces périphériques.
C’est dans cette perspective que nous devons comprendre la situation tragique de Saint-Hyacinthe. Tragique parce que son destin est quasi inéluctable : celle de la substitution de la ville enracinée par la ville jet-set. Notre époque remplace l’ancien monde par le nouveau, dominé par l’instantané, le neuf, la rupture avec les générations précédentes et le refus de la transmission. Mais rappelons-nous ces mots d’Hölderlin : « Là où croît le péril, croît aussi ce qui sauve. » Encore faut-il avoir la volonté de sauver ce monde, qui ne pourra pas s’en tirer tout seul.
Philippe Lorange, Saint-Hyacinthe