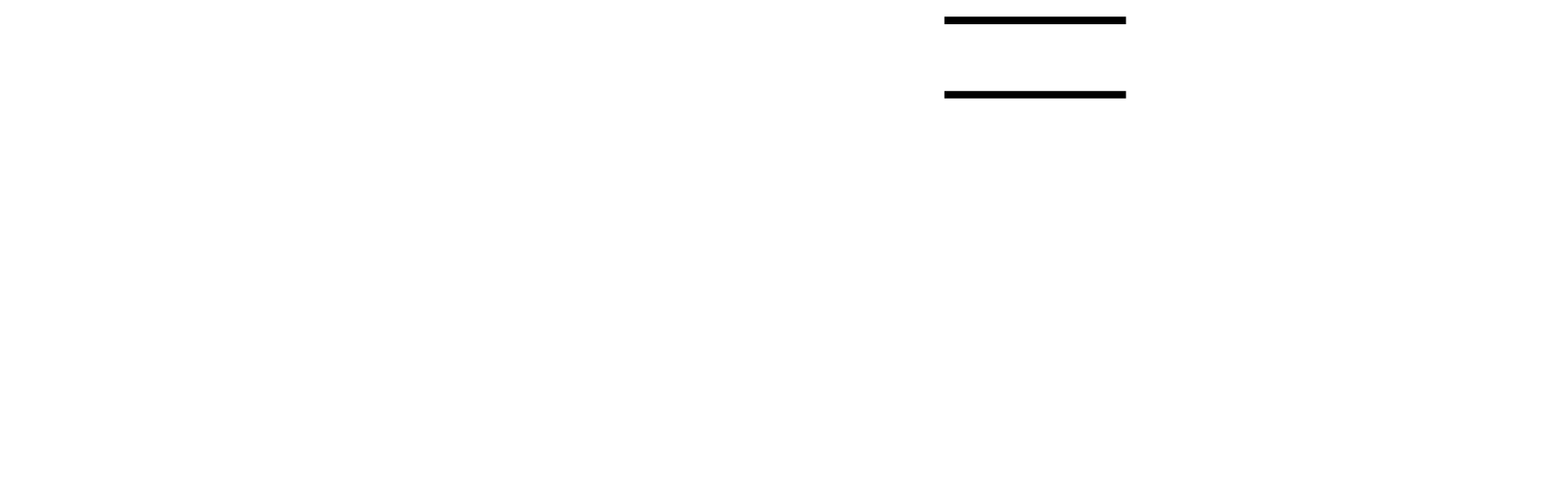Dans le cadre de l’étude, des échantillons ont été prélevés à deux reprises à Saint-Hyacinthe. Les deux fois, la concentration de PFAS s’élevait à 16 ng/l d’eau potable. À titre comparatif, un nanogramme par litre équivaut à un demi-cube de sucre dilué dans la quantité d’eau pouvant remplir le Stade olympique.
Même si Santé Canada s’est penché sur la question, aucune règle n’encadre la concentration de PFAS dans l’eau potable, pour le moment. La recommandation est de 30 ng/l. La United State Environnemental Protection Agency suggère pour sa part une norme, qui n’est pas encore imposée, beaucoup plus sévère, s’élevant à 4 ng/l.
L’étude a analysé 376 sites au Québec. Sept municipalités ont présenté des résultats inquiétants, dépassant la norme proposée par Santé Canada, comme Saguenay et Sainte-Cécile-de-Milton. Entre autres, la Ville de Saguenay a accordé un contrat de 10 M$ à une entreprise afin de détruire les PFAS persistant dans l’eau potable.
Même s’ils sont communément appelés contaminants éternels, ils se dégradent, mais très lentement. Les PFAS proviennent de substances utilisées, entre autres, dans des cosmétiques, dans la mousse pour éteindre les feux, sur les tissus imperméables et les cartons de livraison pour nourriture. Plusieurs facteurs peuvent influencer la contamination de l’eau par les PFAS, comme la présence de sites d’enfouissement, d’exercices d’entraînement de pompiers, d’aéroports, de bases militaires et d’incendies.
Système de filtration impuissant
Ce qu’il faut retenir, c’est que les systèmes de filtration usuels ne permettent pas d’éliminer ces contaminants. Les villes doivent donc investir dans des technologies spécifiques aux PFAS. De leur côté, les citoyens peuvent également se procurer des pichets à filtre qui sont certifiés pour enlever les PFAS. Ce ne sont pas tous les pichets à filtre en vente libre qui ont la capacité de le faire.
« Il existe des procédés qui sont efficaces, mais qui présentent en contrepartie des enjeux majeurs liés à l’environnement et il n’y a pas de consensus présentement au sein des différents ministères impliqués concernant l’ajout de traitements. À Saint-Hyacinthe, selon les analyses de l’étude, la concentration se situe bien en dessous de la norme [recommandée]. Dans ce contexte, la Ville n’envisage pas d’investir dans une technologie de traitement spécifique de ce contaminant. La meilleure approche demeure d’intervenir en amont pour diminuer la présence de ces substances dans la source d’approvisionnement en eau potable », affirme la directrice des communications de la Ville de Saint-Hyacinthe, Lyne Arcand.
La professeure adjointe à l’École de santé publique de l’Université de Montréal, Nolwenn Noisel, rappelle que l’eau est tout de même considérée comme potable selon les critères édités par le Règlement sur la qualité de l’eau potable. Des milliers de produits chimiques existants ne sont pas inclus dans ces critères, mais cela ne veut pas dire qu’ils sont pour autant inoffensifs. Les substances chimiques, comme les PFAS, qui ne sont pas incluses dans le règlement, peuvent, à fortes concentrations et lors d’expositions chroniques, générer des effets sanitaires.
« Il est pertinent de limiter l’exposition aux PFAS, et ce, même si ceux-ci ne sont pas inclus dans le règlement sur l’eau potable parce que la science semble montrer que, même à de très faibles expositions, des effets subtils, pas forcément spécifiques et après de longues périodes de temps, peuvent apparaître. Ce n’est pas facile à démontrer, mais les preuves s’accumulent tranquillement », soutient Mme Noisel.